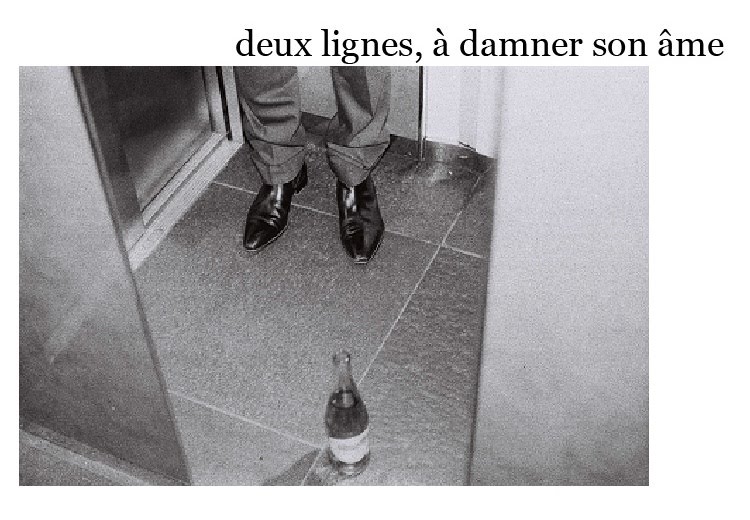Je frotte mon visage incrédule et appuie mon front sur le siège de devant. Objectivement, je suis probablement resté ainsi pendant quelques secondes seulement, mais je n'ai pas encore récupéré ma notion du temps. Je finis par me retourner vers elle et lui souris nerveusement -sourire qu'elle me rend difficilement, une fois qu'elle a décroché ses yeux de la toile redevenue inerte. Ma main plonge d'elle-même dans mon blouson roulé en boule à mes pieds -il a du tomber pendant le film- et en ressort deux cigarettes. Je lui en tends une.
- Oh, ouais, carrément, répond-elle en se levant, apparemment de manière bien trop brusque pour les autres spectateurs.
Nous récupérons nos affaires et sortons du cinéma. Je la suis dans le hall désert, (je crois qu'il est pratiquement minuit) elle et ses deux barrettes bleues, suspendues de toutes leurs forces à ses cheveux noirs. Elle porte un jean moulant bleu foncé, un chemisier à rayures bleues et blanches, un pull noir. Lorsque je la dépasse pour lui ouvrir la porte en fer qui donne sur la place, je remarque qu'elle a changé de parfum. Si tant est qu'elle en ai mis. Mais ce serait bien la première fois qu'elle n'en mettrait pas alors que nous passons la soirée ensemble. Enfin, je laisse doucement la porte chuter dans le silence particulier d'un cinéma fermé.
Dehors, la nuit a pris ses aises, elle a même amené avec elle ce froid qui ne semble plus la quitter depuis une éternité, et quelques passants déambulent encore dans la rue,parfois en groupes, parfois main dans la main, souvent ivres, tous enfouis sous des dizaines d'épaisseurs différentes. La cigarette coincée entre ses lèvres charnues, d'un rose foncé qui va si bien avec sa peau, elle tend la main pour que je lui passe un briquet. J'allume la mienne avec un paquet d'allumettes trouvé je ne sais plus où, et lui passe le paquet machinalement. Tout son visage se tend lorsqu'elle aspire la fumée, et je la regarde l'exhaler rapidement, mêlée à son haleine que le froid rend visible -ses yeux se perdent quelque part sur le sol.
- Putain, finis-je par lâcher, en ayant laissé traîné la première syllabe lentement. À ce moment là, un courant d'air froid s'insinue sous ma chemise et le sillon glacial qu'il laisse derrière lui me fait grelotter violemment.
- C'est le mot, mon grand.
Elle finit par me regarder; ce sont toujours ces iris bruns tellement banals que je les trouve exceptionnels. Comme j'avais cru comprendre avant la séance - ce qui me semble être une époque aussi lointaine que lorsqu'elle n'avait d'yeux que pour moi- qu'elle avait faim, je lui propose d'aller au MacDo, puisqu'il n'y a rien d'autre d'ouvert à cette heure-ci, sauf des échoppes de kebab qui provoqueraient une crise cardiaque chez n'importe quel inspecteur du Service de l'Hygiène. Elle acquiesce vivement de la tête et passe devant.
Pendant le trajet, nous avons une conversation si superficielle que c'en est affligeant. Enfin, pour une tierce personne, elle ne serait pas si affligeante que ça; mais on parle du film, et rien que le fait d'en parler -quoi qu'on en dise-, ça a l'air incroyablement moins profond que ce qui vient de se passer, dans la petite salle que nous laissons derrière nous. Je ne parle pas beaucoup, je me contente d'acquiescer à chacune de ses remarques, et parfois de renchérir en utilisant en bout de mon vocabulaire technique du cinéma qui, même limité, crée l'impression que je suis compétent en la matière. Un couple nous croise, littéralement imbriqués l'un dans l'autre, et ça la fait rire. Au fur et à mesure que nous remontons la rue piétonne, aux dalles glissantes et aux murs blafards, ses pas s'accélèrent -l'appel de la faim, chez une jeune fille ?- et elle continue de parler, même si elle ne désire apparemment pas avec aucune interaction d'aucune sorte avec moi; ses mots semblent plutôt tenir le silence en respect, ce silence qui guette au tournant de chaque phrase, menaçant de prendre ses quartiers définitivement. Heureusement pour elle -et pour moi ?-, les bouffées qu'elle tire frénétiquement sur sa cigarette lui procurent quelques instants de répit, encore eut-il fallu qu'elles eussent été méritées, jusqu'à ce que nous arrivions devant ces lourdes portes vitrées desquelles il semble toujours émaner cette odeur qui nous écœure et nous allèche en même temps, tout comme on ne peut s'empêcher de passer sa langue sur une gencive trop sensible. De l'autre côté, quelques tables sont empilées dans une lumière tamisée, une serpillère traîne sur le sol, intruse grise dans un monde jaunâtre, et, au fond, des centaines de burgers rangés militairement sur des plateaux en fer blanc, luisants sous les néons vacillants.
Sans se préoccuper du fait qu'il semble n'y avoir personne à l'intérieur, elle entre en s'affaissant de tout son poids sur l'un des battants, qui résiste; elle manque de trébucher lorsque les gonds se débloquent, et toutes les effluves graisseuses se répandent au dehors. Je n'ai pas fini ma cigarette mais je la jette nonchalamment derrière moi, sans la regarder ricocher, et marquer chacun de ses impacts au sol par une gerbe de braises. Elle ne m'a pas attendu et, appuyée sur le comptoir, elle se hisse sur la pointe des pieds -même si elle porte des talons, ce qui me fait sourire- pour essayer d'apercevoir un caissier dans le dédale des cuisines qui s'étend sous nos yeux, friteuses, égouttoirs, fours et autres postes de travail rutilants, lavés après une journée de labeur de plus. Il n'y a vraiment personne. Sur notre gauche, un escalier qui baigne dans une semi-pénombre est barré par des chaises pour enfants en bois sombre avec des dessins de clown sur les dossiers. À droite, à quelques mètres seulement, il y a une seconde sortie -le bâtiment fait le coin-, avec les mêmes portes vitrées nous remerciant de notre visite et laissant transparaître ces mêmes silhouettes de jeunes groupés hurlant leur ivresse, ces mêmes jeunes femmes en robe longue, le portable collé à l'oreille -« Allô ? Mais vous êtes OÙ ? »-, ces mêmes clochards errants dans les mêmes rues qu'ils ont sillonné hier soir. C'est dingue ce que cette ville peut ne pas changer, depuis le temps que j'y habite, et c'est dingue ce que les gens semblent ne pas changer.
Je suis toujours au milieu de la salle, entouré par une horde hétéroclite de chaises, de tables, de sacs poubelles et d'affiches diététiques froissées. Au moment où je m'approche d'elle, ou plutôt de son dos, de sa nuque découverte par ses cheveux qui reposent tantôt sur une épaule, tantôt sur l'autre, puisque sa tête cherche frénétiquement, de droite à gauche, quelqu'un qui puisse la servir, pour lui dire qu'en fait on peut trouver de quoi dîner trois rues plus loin -une invitation à dîner !-, un roulement de tambour se fait entendre, des pas dans l'escalier. Elle se retourne instantanément, son épaule frotte contre ma chemise, et observe un type, maigre comme la mort, les yeux s'agitant dans tous les sens, prisonniers de leurs orbites, enjamber tant bien que mal la barricade de chaises pour moins de 36 mois.
Il bafouille quelques mots d'excuse, elle commande et, deux minutes plus tard qui m'auront semblé être une éternité -Alfred, encore ?-, nous ressortons de l'autre côté, débouchant sur un carrefour qui, sous la bruine froide ayant commencé à recouvrir toute la ville de son voile éthéré pendant que nous étions encore à l'abri, semble étendre ses quatre artères jusqu'au bout du monde; les pavés qui brillent sous les rayons crus des lampadaires ressemblent à un chemin d'étoiles. Elle, s'en fout, et emprunte la rue d'en face, mordant avidement dans son sandwich.
Les grands immeubles de pierre beige encadrent sa silhouette qui s'enfonce dans une obscurité percée par les les reflets que projettent phares et plaques d'immatriculation, découverts par les réverbères solennels bordant la rue dans laquelle je me trouve encore. La bouche à moitié pleine d'un hamburger qu'elle tient fermement dans sa si petite main, elle essaie d'articuler ce qui, j'espère, est une invitation à la suivre. Je fais mine de ne pas vouloir suivre ses pas, que j'emboite sans hésiter à la minute où elle continue son chemin. Pendant quelque temps, nous marchons quasiment côte-à-côte, séparés de cinquante incompressibles centimètres, dans un dédale de rue semblant avoir été tracé au hasard par un urbaniste qui, un soir, ivre, aurait jeté son anticonformisme à la face du monde en refusant de faire un seul angle droit, une seule route lisse, un seul trottoir suffisamment large pour qu'on puisse marcher à côté de quelqu'un sans le toucher. Et pourtant, elle semble désespérément loin de moi et sa main qui, cet été, se balançait puérilement à la recherche de la mienne, essuie désormais ses adorables lèvres graisseuses. Nous passons silencieusement devant un appartement illuminé, criard, fumant, d'où jaillissent des rafales de basses; et lorsque nous nous arrêtons pour qu'elle puisse voir -en se hissant jusqu'à la fenêtre- si elle connait quelqu'un, parmi les corps adolescents qui vaquent au milieu du salon, je peux voir ses cheveux -ces mèches fines qui à contre-jour, forment une auréole- vibrer discrètement sur ses épaules. Déçue, elle continue sa route et je la suis, n'essayant même plus d'entamer la conversation; quelle conversation ? Son pas régulier, ses bottines semblent savoir parfaitement où aller, et je les suis aveuglément, je les suis sans perdre de temps, je les suis presque avec mon sang.
Dès que, au détour d'une courbure du trottoir, des rires retentissent contre les pavés encore humides, et rebondissent contre les nuages amassés si bas, elle bifurque à l'opposé en faisant valser ses cheveux et son sac à main de cuir scintillant. Dans la nuit qui nous enveloppe, le genre de nuit qui nous fait oublier qu'il a déjà fait jour, je me résous à lui agripper le bout de la manche et, pendant une fraction de seconde, j'ai l'impression qu'elle continue à marcher, comme si je m'étais noyé dans un lac gelé, englouti par la glace qui se fissure et se referme au-dessus de mes mains affolées et les cris qui s'échappent de mes poumons sous forme de si jolies bulles d'air. Puis la mortelle et transparente couverture s'évapore et son visage m'apparaît.
- Qu'est-ce qu'il y a ? demande-t-elle comme une mère qu'on dérange pendant qu'elle téléphone.
Au diable Hitchcock, les étoiles et mes divagations. L'adolescente qui se tient impatiemment devant moi, banale, belle, si banale, m'a renvoyé hors de la notion que je me fais du temps. Je m'étais entraîné si souvent a répéter ces mots, sous la douche, sur ma mobylette, sous ma couette, que je ne suis plus capable, face à son regard qui se fiche dans mes yeux -je ne sais plus si je la regarde encore- de dire quoi que ce soit. Et pourtant, deux ans, deux minutes, deux vies plus tard qu'elle ne l'aurait voulu, une partie inconsciente de mois et inconsciente des conséquences que cela aura sûrement, lui dit que le grand garçon aux cheveux sales et bouclés, les mains fichées dans les poches, qui se tient avec une assurance de plus en plus bancale devant elle, est fou amoureux d'elle.
Je ne vois pas sa réaction, je ne vois plus que moi, nu, mon armure de chevalier sans peur et sans reprochant valsant dans l'air froid de la nuit qui la faisait frissonner, il y a quelque temps. Dans ce silence écorché, sa voix surgit de nulle part, tout autour de moi.
- Mais, … Je sors avec Clarence, maintenant, tu ne peux pas me faire ça, pas maintenant, bafouille-t-elle d'une voix nerveuse qui serre mon cœur dans son étau involontaire.
Personne n'en a rien à foutre, que tu sortes avec un quelconque inconnu qui n'a pour mérite que d'avoir un pull Abercrombie&Fitch, personne ne vous prend au sérieux, ta jeunesse affreusement peu volage et toi. Et moi, je ne vois pas pourquoi tu devais absolument répondre ce que n'importe quel scénariste de mélodrame américano-médiocre aurait fait dire à une grande blonde perchée sur ses talons, et sur la Cinquième Avenue.
Elle pense que mon silence l'impose de rajouter quelque chose, de justifier quoi que ce soit. Et alors que, toujours face à elle, même si ma main a laissé sa manche chuter jusqu'à heurter délicatement son bassin, ce bassin dont je connais tous les détails, je reviens doucement à une réalité qui me rit au nez, un clochard et son chien émergent d'un coin d'ombre derrière elle, l'un aussi ivre que l'autre est perdu. Le jeune titube jusqu'au trottoir, et traîne dans son sillage alcoolique sa bête par un collier fabriqué en corde de chanvre, probablement dénichée dans un chantier abandonné. Elle ne s'est pas retournée, et je les suis vaguement du regard jusqu'au moment où je me décide à lui dire que ce n'est pas grave, que tout restera pareil, que j'ai été con de dire ça -rien de plus facile pour effacer une erreur que de se déprécier spontanément. Je prends une brève inspiration, au moment où l'animal se retourne brutalement, arrachant ses liens des mains hésitantes de celui qui l'a trouvé. En quelques foulées, son museau touche le jean bleu foncé, et il ne lui faut moins d'une seconde pour se hisser sur ses pattes arrière et ouvrir la gueule. La première morsure arrache son oreille, des mèches de cheveux bruns et une barrette qui s'y était perdue. La seconde -elle est tombée à terre et hurle de douleur- lui emporte la peau soyeuse que j'ai caressée mille fois. La troisième enfonce des crocs jaunâtres dans sa gencive révélée. La cinquième et la sixième s'occupent de son petit nez et de ses yeux noisettes -les hurlements se font plus faibles, elle a du mal à reprendre sa respiration, mais elle continue à gigoter. Au bout d'un moment, alors qu'il a mis a nu son épaule droite et qu'il l'embrasse férocement avec sa gueule noire, je lance mon pied sous sa mâchoire -un réflexe ?- et le vois reculer en titubant, avant de repartir en gémissant vers son maître ébahi -du moins, autant que lui permet l'alcool. Ils vacillent dans l'obscurité, et disparaissent à jamais.
Les trottoirs sont tellement étroits que même son corps fin traîne partiellement dans un caniveau si sombre qu'on pourrait s'en servir pour y tremper une plume et écrire un épitaphe à même le mur. Elle sanglote, et ses lèvres déchirées invoquent inutilement sa mère, son père, son frère, ce Clarence, pendant que ses doigts se hissent difficilement jusqu'à ce qui fut son visage pour palper ses blessures rouge vif -même son sang est envoûtant, si charmant qu'il sèche paresseusement sur son visage, refusant de choir sur le bitume sale. Je sors mon téléphone portable de ma poche, et trouve par la même occasion une cigarette alors que je pensais avoir fumé la dernière tout à l'heure, je compose un numéro des urgences et tombe sur la gendarmerie. Je n'ai jamais pu retenir ces numéros simplistes, me dis-je en allumant ma clope et en essayant un autre dix-quelque chose. Une secrétaire fatiguée me répond et je lui dis que je suis devant une jeune fille blessée par un superbe berger allemand, mais que je ne sais pas où je suis. Vu l'heure, elle pense que je suis ivre et me dit que c'est ridicule de ma part de lui faire perdre son temps et que, en ce moment, un illustre inconnu est peut-être en danger de mort, la tête gisant dans un caniveau; elle raccroche. Les mains palpent et les lèvres psalmodient toujours, ses paupières clignent très vite et ses iris bruns ne me regardent plus que par saccades. Je rappelle la secrétaire ménopausée et lui dis que je ne suis pas ivre et que la jeune fille a besoin d'aide. Elle m'engueule une nouvelle fois. Je finis ma cigarette dans un ciel qui s'éclaircit peu à peu, puis m'accroupis à côté du sac à main, cherche un portable, le trouve, déniche le numéro de téléphone de Clarence, l'appelle, lui dis que sa copine bien-aimée ne va pas très bien, raccroche et ai soulagé ma conscience. Je repose le portable dans le sac à main qui, lui, n'a rien et me laisse tomber contre le mur derrière moi, inébranlable. Mon pied touche le bout de ses orteils.
Elle respire encore, faiblement, mais régulièrement, et je me dis que c'est dommage, que je ne suis pas amoureux d'elle, que je suis juste en manque d'affection -il paraît que je suis aussi soumis à ces démons irascibles et agités qu'on appelle hormones-, que je voulais voir ce que ça faisait, une déclaration d'amour. Alors, je lui prends la main, douce et chaude, et j'attends qu'un nouveau jour nous enveloppe de son lot d'espoirs illusoires, hagards; Chloé, moi.