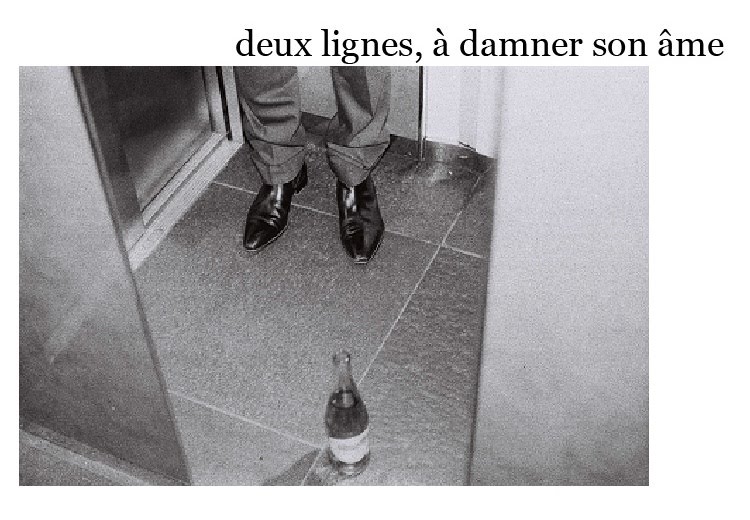Le métro arrive, je vais penser à autre chose. Alors que la masse se précipite dans les rames en ne laissant que la moitié des passagers descendre tranquillement, je monte en dernier, pendant que les sirènes de Londres indiquent la fermeture imminente des portes et conseillent aux passagers de se tenir éloignés de ces dernières, afin de ne pas s'y coincer les doigts.
Il y a une jolie fille, pas loin de moi, qui a quelque chose de familier. Je croise son regard, et là, -ô joie, ô surprise !- elle le soutient, pendant ce qui me semble être une éternité mais qui n’a sûrement duré qu’une volée de secondes. Enfin quelqu’un qui soit esthétiquement agréable et qui assume de se faire mater par des mecs le matin dans le métro -et puis, n’abusons pas, je ne suis pas si laid que ça. Elle porte une robe verte, une très jolie et très seyante robe verte qui va très bien avec ses long cheveux blonds. Et lesdits cheveux dorés font ressortir ses yeux bleus (oui, je sais, j’aime les blondes aux yeux bleus, je n’ai aucune originalité, etc.), tout en accentuant parfaitement les traits délicats de son visage, ses lèvres d'un rose étonnement pâle, son nez discret.
En fait, elle n’est pas jolie, elle est absolument époustouflante. Et, tout d‘un coup, ça me vient à l'esprit, en prévenant encore moins qu'une pensée ordinaire: Lara. Elle doit s‘appeler Lara, c‘est sûr et certain.
Il va pourtant falloir que je trouve quelque chose pour faire comme si je n’étais pas du tout intéressé par cette créature angélique, et éviter de passer pour un obsédé…
« Chloé me déteste ». Non, encore autre chose.
Trouvé: il doit y avoir Doctor Sax dans mon sac. Je le sors, et après avoir trouvé une place sur un strapontin pourri qui ait pourtant l'immense mérite de me permette de garder un contact visuel, je commence subtilement à alterner entre l’écriture de Kerouac et les yeux de Lara, entre l’enfance de Duluoz et les lèvres de Lara, entre les nuits de Sax et le décolleté de Lara -lequel oscille dangereusement entre l’élégance et l’indécence. Le jeu des passagers embarquant et débarquant nous rapproche de manière purement hasardeuse l’un de l’autre. Mon regard est alors happé par quelque chose de scandaleux, d’absolument intolérable. Sa robe s'évanouit subtilement au niveau de sa cuisse pour céder la place à une paire de jambes qui aurait immédiatement fait douter Pascal, Descartes, Kant & Co. quand à l’apparence de Dieu. Ce n’est pas possible, une fille aussi belle n’existe pas, même si, vu le nombre de types qui la matent allègrement, elle existe bel et bien pour pas mal d’entre eux. Mais -et là encore, ô joie, ô surprise !-, elle ne regarde que moi. Ou peut être un mec derrière moi, mais j’ai foutrement l’impression que ce sont mes yeux qui la captivent, heureusement que je me suis rasé ce matin. Enfin, pendant qu’elle semble absorbée par son téléphone portable, j’ai quand même droit à quelque subtils et très vifs coup d’oeils, l’air de dire: « Tiens, t’as l’air pas mal, toi, mais comme je suis pas une grosse pouffe aguicheuse, je ne vais quand même pas te fixer ostensiblement ».
Je ne sais pas combien de temps dure ce petit jeu, mais j’ai quand même eu le temps de m’enfiler l’intégralité du Piper At The Gates Of Dawn.
Et puis, d’un coup, elle se lève et sort du métro. J’ai à peine le temps de la suivre. Je ne sais pas où je suis, mais ça tombe bien, j’ai envie d’une clope. Je suis Lara sans savoir où elle va, mais du moment que ses jambes me guident, j’irai jusqu’au bout du monde. Finalement, une sortie est en vue; j’accélère alors le pas, histoire de me mettre juste derrière mon inconnue. Sur l’escalator, je sors mon paquet, encore plus froissé que la dernière fois que je l'ai amputé d'une cigarette. J’ai de la chance, il m’en reste une, mais, étrangement, je ne retrouve pas mon briquet.
Nous sommes à l’air libre, et à Saint-Denis, par la même occasion. Je prends mon courage à deux mains, me persuade qu’elle ne va pas me manger et effleure son bras dénudé.
« Excuse-moi, tu aurais un briquet ? »
Elle se retient de sourire. Salope, si tu savais à quel point c’est dur d’aborder une inconnue aussi bien foutue que toi.
« Oui, bien sûr, attends, répond-elle alors que ses doigts fouillent dans son sac à main. Elle la voix d’une fille qui devrait s’appeler Lara. J’en profite pour enchaîner:
« Et tu t’appelles comment ? »
Les doigts arrêtent de fouiller.
« Excuse-moi ? » Ma superbe blonde est entrain de se dire que le mec mignon (?) du métro n’est qu’un dragueur minable.
« J’ai une admiration sans bornes pour les jeunes filles qui se promènent dans le métro en robe légère. Jusqu’à Saint-Denis, qui plus est. »
Les doigts se remettent à fouiller. Elle tente un sourire timide et me tend un briquet rose clair avec des chatons dessus. Personne n’est parfait, me dis-je en allumant ma cigarette.
J'aspire consciencieusement une dose de nicotine, totalement focalisé sur mon apparence -je ressemble assez à Bogart ?
« Et donc, tu t’appelles comment ?
- Tu ne m’as pas dit merci, pour le briquet.
- Merci profondément, sans ton aide providentielle, j’étais foutu. Connaître ton prénom serait encore plus gratifiant, lui dis-je avec le plus sincère des sourires.
- Peut-être bien. Et toi, c’est comment ?
- C’est moi qui ai posé la question en premier.
- C’est faux.
- Peut-être qu’avec des jambes comme les tiennes, tu rencontres peu de mecs qui te disent ça mais, le fait est là: c'est moi qui ai raison, pas toi.
- Les jolies filles ont toujours raison. »
Pause. Je croyais être le seul à connaître cette ligne. Et voilà que débarque allègrement une blonde -et ses jambes insolentes- qui semble avoir une parfaite connaissance de la psychologie de Lucy. Ce que je réalise à peine, là, tout de suite, c’est que je viens de tomber sur une demoiselle, jeune et jolie, qui a les même valeurs que moi, et qui ne le sait pas. Le flux temporel vient d'avoir un hoquet, rien qu‘à cause d‘une petite citation de rien du tout parue dans un journal du Sud américain dans les années 60... Et pourtant, Chloé me déteste toujours.
« Arrête de plagier les Peanuts.
- Je pensais pas que tu connaitrais. Tu me dis ton nom ? »
Je tire une autre longue bouffée.
« Je t’intéresse tant que ça ?
- Il est six heures à Saint-Denis, tu veux que j’aille parler à qui ? Au patron du PMU ?
- Même si j'ai envie de dire que ce doit sûrement être un individu riche et profondément humain, tu marques un point. » Elle ne rit pas à mon ironie, supposée être irrésistible.
Alors que je commence à marcher vers la basilique, Lara me suit, je ne sais pas pourquoi -un sentiment génial de satisfaction s‘empare de tout mon être: égoïsme basique, je sais, mais qu’y puis-je ?
« Et si je te demande ce que tu fais ici, j'aurais droit à une réponse ?
- Disons que j‘avais une envie compulsive de prendre le métro tôt le matin.
- Et tu viens d’où ?
- Ça, tu ne le saura pas non plus.
- OK.
- Je te trouve bien curieux, d’ailleurs. Ta mère ne t'a jamais appris à ne pas embêter les jeunes filles ?
- Que veux-tu ? Il est six heures et on est à Saint-Denis. »
Elle sourit discrètement, et je regarde mes pieds, puis le soleil qui s'étire derrière l'unique clocher de la basilique asymétrique, pour éviter de lui sourire à mon tour, témoin insupportable d'une illusoire complicité.
« Bien joué.
- Je sais.
Un temps passe. Ainsi qu'une mère de famille africaine avec une demi-douzaine de baguettes étouffant sous son bras.
- Orgueilleux et curieux. Tout ce que je déteste.
- Dans ce cas, on n’est pas fait pour s’entendre. »
Il y a des bancs devant la basilique. Je m’assieds, je contemple avec pitié ce qui me reste de ma clope puis je jette un regard interrogateur à Lara qui est restée debout. Elle semble hésiter, et opte finalement pour le banc, même si elle reste quand même bien loin de moi. Je finis ma cigarette, relève la tête et lui demande:
« T’as déjà visité la basilique ?
- Non, jamais. Qu’est-ce qu’elle a de spécial ?
- La quasi-totalité des Rois de France y sont enterrés.
- Si c’est pas génial, ça.
- Ouais, on ira visiter ?
- Peut-être.
- Le respect des ancêtres est très important, paraît-il (Dieu ce que c’est nul, comme réplique).
- Sûrement, sauf que je viens pas de France…
le doute, présent implicitement depuis le début, devient de plus en plus présent. Ne me dis pas que tu es russe, Lara, ne me dis pas que tu es russe…
- Je suis russe. Et je ne sais même pas où son enterrés les tsars.
Et merde. On s'en contrefout, des tombes d'une dizaine de despotes consanguins qui ont régné il y a plus d'un siècle. Mais elle est effectivement russe. Qu’est-ce que je peux répondre à ça ? C’est carrément de la provocation, une jeune fille blonde qui virevolte dans la neige en buvant de la vodka et savourant coupelles dorées de caviar sur coupelles dorées. Mais bon, j’essaie quand même, sans trop tomber du ah-t’es-bonne-parce-que-t’es russe et autres ouais-c’est-cool-le-communisme:
- Ceci explique cela. »
Elle me jette alors un regard qui dit me transmet explicitement son point de vue: tu es le roi des cons, et je ne sais pas ce que je fous ici.
« Vous êtes tous pareils, les mecs. Dès que je dis que je suis russe, vos yeux s’allument.
- Je suis pas comme les autres mecs.
- Ils disent tous ça.
- Et vous dites toutes ça.
- Nan. »
Stop. Elle n’a pas dit « non », elle a dit « nan ». Et c’est une des choses les plus érotiques que j’ai entendu depuis très longtemps (Kiss me as if it were the last time, disait Ingrid). Il va falloir que je me calme très vite, même si sa robe ne m’aide définitivement pas.
« Bon, sortons du registre du flirt ringard. Dis-moi ce que tu fais ici.
- Nan. »
Mais comment peut-on arriver à établir une conversation normale avec une fille aussi belle qu’elle ? Je veux dire, il suffit qu’elle ne dise qu’un mot pour que j’ai envie séparer son corps de ses vêtements, de profaner chacune des tombes enterrées à quelques mètres d'ici, de faire ce que Jim Morrisson ne pouvait pas, tant que c’est elle qui me l’ordonne. Le pire, c’est qu’entre ses lèvres qui susurrent un « nan » et mon ego, je choisis les lèvres; elle laisse durer le « n » si longtemps, la langue à moitié tirée entre les dents -une petite langue rose et délicate-, que quand arrive le « -an », bref, montant immédiatement dans les aigus, ses yeux se plissent, se mettent à briller, et ma raison à hurler de terreur.
« Chloé me déteste ? Nan. »
Il va falloir que j'arrête d'être obsédé par les mimiques ridicules de jolies filles. Si je commence à tomber dans la contemplation passive d’une beauté qui n’existe que par l’intermédiaire de maquillage et de décolletés outrageants alors que je ne suis pas encore marié, c'est mal parti. Cette fille est vraiment malsaine: elle arrive à me faire divaguer à partir d‘un seul mot qu‘elle prononce, moi, celui qu’on appelle « l’homme qui ne pense qu’à lui ». Enfin.
Je me calme, je me concentre.
Repartons sur des bases plus réelles, et fuyons l'esthétique inexplicable. Il est inconcevable que je renonce à connaître la (ou les) raisons qui ont poussé une des plus jolies filles de Paris à aller à Saint-Denis un samedi matin: je suis bien trop têtu pour ça. Dans cette optique, j'enchaîne en faisant comme si c'était la première fois que je lui posais cette question.
« Si tu me dis ce que tu fais ici, je te dirais ce que moi je fais là.
- Mais ça, je m’en fous complètement, laisse-t-elle échapper en regardant quelque part près de mon genou.
Et merde. Il faut que je me rattrape.
- Dommage, ça impliquait la mafia locale, le zoo de Melbourne et le deal d'ornythorinques de l’année.
Elle me dévisage à peine, même si ses yeux semblent désormais être posés sur ma main -sale, qui pue le tabac froid.
- Arrête, t’es pathétique.
Soyons beaux joueurs, et accordons-lui qu'il y a effectivement de quoi faire en matière de ridicule.
- Ouais, je sais, c’est pas comme si j’étais une jeune fille qui, sous prétexte qu’elle a ses règles, refuse de répondre à une question innocente d’un inconnu qu’elle connaît depuis à peine une demi-heure.
- J’ai pas mes règles ! Crie-t-elle presque. »
Touchée. J’arrive enfin à la faire réagir autrement que par le dédain ou par des coups d’œil qu’elle pense être furtifs Même si le côté aguicheur de ces derniers sont apparemment restés sous terre.
« Alors tu n’as pas de raison de ne pas me le dire.
- Peut-être pas, non. Mais si je refuse de dire quoi que ce soit, on va continuer à se regarder en chiens de faïence, et c’est toi qui cèdera le premier.
- N’essaie pas, ça risque de durer plus longtemps que tu ne le crois. Et Saint-Denis n’est pas connu pour son ambiance nocturne bon enfant.
- Vous êtes tous pareils, à sous-estimer la volonté des femmes. »
À noter qu’elle n’a pas dit « filles », même si la demoiselle assise à côté de moi semble à peine dépasser les dix-huit ans.
« Écoute, on va faire un deal…
Son hochement de tête qui fait écho à un son inarticulé du fond de sa gorge m'invite à poursuivre.
- Je te laisse garder le silence quant à la raison de ton excursion matinale, et tu renonces à ton discours féministe -qui, par la même occasion, m’associe à la masse compacte de tous les autres hommes que tu aies connus, quoi que je fasse. OK ?
- Si ça peut te faire plaisir.
- Tu n’imagines pas à quel point. »
Elle se tait. Je cherche désespérément une autre cigarette. Que je ne trouve, pas, en dépit d’un examen approfondi de chacune de chacune de mes poches.
Le café d’à côté s’allume, le patron commence à sortir les tables de la terrasse, les unes après les autres et les dispose consciencieusement devant son établissement. C’est impressionnant de voir à quel point il effectue son travail avec application, même si ça doit faire une éternité qu’il le fait. Il paraît que la routine rassure la plupart des individus de notre société; le quotidien les empêche de s’inquiéter. Les tables, d’abord, placées géométriquement. Puis les chaises, qu’il porte deux par deux, et qu’il dispose auprès de chaque table, une de chaque côté, légèrement rapprochées pour que les clients puissent tous les deux avoir une vue sur la basilique. Ensuite, les parasols, pour que la vue en question ne soit pas gâchée par un soleil trop fort. Il amène alors les cendriers, un toutes les deux tables, législation oblige. Une fois son labeur accompli, il prend une petite pause pour contempler son œuvre, aussi impeccable qu’hier matin. Et qu’avant-hier. Et ainsi de suite. On sentirait presque la satisfaction qu’il retire de ne pas succomber au changement. Je me demande si il n’a jamais envisagé de faire trois rangées de quatre tables, au lieu de quatre rangées de trois tables. Mais ce n’est sûrement pas le cas; au-delà de son propre malaise, il désorienterait alors complètement ses habitués aux quatre rangées de trois tables. Le client est roi, même si il est con.
Lara ne parle toujours pas. Elle aussi observe le patron du café. Est-ce qu’elle aussi a remarqué sa fierté d’avoir tout fait bien comme il faut ? Je demande.
« Ce mec est l’exemple même du concept de régularité et d’assiduité quotidienne.
- C’est triste. Et pourtant, il a l’air heureux. Je veux dire, je trouve ça triste.
- C’est pire. Quand on commence à se complaire en territoire connu et maîtrisé, on entame alors une irrésistible décadence.
- Pas forcément irrésistible. On peut se sortir du quotidien, même si ça demande plus d’efforts avec le temps.
- Ouais, comme toi. »
Son visage se retourne vers moi, entraînant avec lui ses cheveux blonds dans un mouvement digne d’une pub pour shampooing hollywoodien.
« Tu viens de dire quoi ? Lâche-t-elle après un temps d’hésitation.
- Le fait que je te laisse la possibilité de ne pas me dire ce que tu fais là ne veut pas dire que je ne vais pas essayer de deviner. »
Son visage se referme immédiatement, mais ne se retourne pas pour autant. Le patron satisfait se sert un café. J’enchaîne de la manière la plus naturelle du monde:
« Tu es là parce que tu t’ennuies. »
Un soupir de mépris s’échappe de ses si jolies lèvres.
« Et toi, tu penses évidemment que je suis un gosse de riche qui a trop de temps à revendre alors il tente l’aventure dans le métro un samedi matin en espérant trouver une inspiration romantique -au sens littéraire du terme- et finit par psychanalyser une inconnue ? »
Pas un mot.
« Si ça te fait plaisir de continuer à le penser, je ne vais pas t’en empêcher, ma grande. Et pour ce qui est de la psychanalyse, c‘est pas faux.»
Toujours pas un mot, mais au moment où elle entend « ma grande », ses yeux me transpercent; comme quoi, elles sont toutes les mêmes. Mais je me tais, en attendant que ça vienne. Parce que ça viendra, ça vient toujours: les gens sont trop isolés pour refuser une occasion de se plaindre et de se confier. Et puis, j’ai tout mon temps; le soleil illumine de plus en plus la cathédrale.