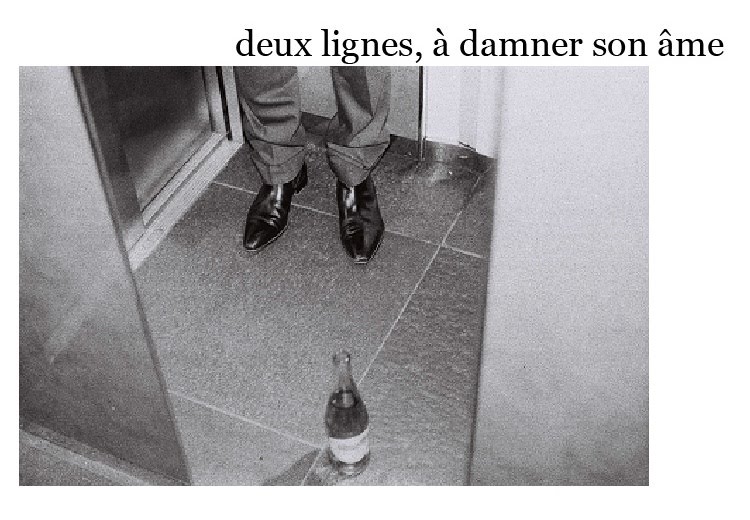Me voilà, courant le long du boulevard S., sans regarder des affiches colorées qui exaltent soldes, promotions et fermetures en attendant patiemment d'être dépassées, l'une après l'autre. Elles sont devenues le décor irréel d'une interminable piste de course qui n'existe que dans mon crâne. Je ne sais pas si je poursuis la tache bleue foncée aux bracelets dorés qui vient de s'engouffrer dans la rue de droite ou si je tente d'échapper à cette lueur tamisée, disparaissant peu à peu derrière mon épaule, du troisième étage d'un immeuble d'un appartement tout à fait correct du sixième arrondissement, quartier agréable, voisinage tranquille, préférant jeunes cadres riches et occupés, mais je suis conscient que je cours de toute mes forces, distordant mes muscles pour rattraper, ou pour fuir, une réalité à tête de femme. Il reste encore quelques passants solitaires, rentrant paisiblement au domicile conjugal, et de rares serveurs fatigués, fumant leur dernière cigarette avant leur débauche, qui me regardent d'un air curieux, comme on regarde un clochard qui refuse de faire l'aumône, ou une jeune fille qui s'est teint les cheveux en rose. On ne voit pas assez de gens courir. Le temps de parcourir une centaine de mètres, et je n'y fais déjà plus attention, et tous les spectateurs que j'ai laissé derrière moi ne se sont sans doute pas retournés.
Au-delà du simple effort physique, courir a l'étonnante faculté de nous faire oublier pourquoi nous faisons cela; arrivés à notre vitesse de croisière, l'esprit n'est plus monopolisé que par les reliefs du sol, ceux qui pourraient s'avérer être des appuis efficaces, ceux qu'il faut éviter sans perdre de temps, et par l'arrivée, par l'endroit, la chose ou l'individu qui perd alors toute définition pour ne devenir plus que ce qu'il faut atteindre, le plus vite possible. Le flux de pensées qui nous a poussés à nous précipiter à pleine vitesse au milieu des autres - des marcheurs-, se retire alors, somnole discrètement avant que des halètements et des douleurs à l'abdomen ne le préviennent de la fin du périple, et de la nécessité de reprendre nos esprits. De manière plus évidente, les regards, indignés ou curieux, que nous jettent les passants lorsque nous les esquivons prestement finissent par ne plus nous atteindre, et par ne plus être perçus. Et même si, de temps à autres, l'un ou l'autre nous adresse un discret sourire d'encouragement, nous libère le passage ou se contente simplement de se sentir concerné par l'effort que nous accomplissons, seuls comptent le regard que nous posons sur l'arrivée, et celui qu'elle daigne parfois nous adresser.
Dans l'immédiat, mon arrivée à moi, une jeune femme blonde, qui -ayant le même âge que moi- ne fait pas ses vingt-six ans, se dérobe aux contours floutés de mon champ de vision au bras d'une silhouette noire enchemisée et encravatée. Sa démarche et ses chaussures, bien que apparemment assurées parce que masculino-machiste, me frappèrent, la première fois que je les ai croisées sur le seuil de mon appartement, par leur habitude à fouler des tapis feutrés de bureaux à baies vitrées plutôt que toute autre surface. Et c'est à côté de ce genre de type que marche Charlotte. Dont le sillon vient d'être tranché dans le vif par un torrent de phares et de pneus, libérés subitement par l'apparition d'un feu vert. Je ne sais jamais quoi faire lorsque je vois mon trajet devenu subitement impraticable. Ma conscience redevient alerte, et cherche avec affolement un itinéraire alternatif qui n'interromprait pas le flux d'adrénaline qui m'a porté jusqu'ici. Je me risque à ne pas ralentir, et à utiliser le panneau Cédez Le Passage pour profiter le l'énergie centrifuge de mon corps et optimiser mon virage à droite. Réminiscences lycéennes d'un laboratoire de physique. Surprise, mon épaule s'engouffre en première dans la rue J., et par la même occasion, entre deux hommes, légèrement plus jeunes et moins bien habillés que moi, surpris sur le chemin du retour de leur bar qui sert des pintes à quatre euros par un fou à pleine vitesse. À bout de souffle, je me retourne brièvement vers eux pour leur adresser un coup d'œil désolé, puis continue ma route, enjambant les quelques mètres qui séparent deux voitures pour me retrouver sur le trottoir d'en face, tourner à gauche en ignorant les deux coups de klaxons qui me réprimandent. Deux devantures de bistrot plus loin, et c'est le coin de la rue B. -qui recèle Charlotte, ses ballerines noires et son sac à main en cuir mat-, le long de laquelle se dressent une demi-douzaine de voitures mal garées, autant de policiers griffonnant sur leurs calepins d'incessants numéros d'immatriculation, encore quelques passants innocemment éméchés, et un type anodin qui n'a toujours pas lâché la main de mon arrivée. Conscient d'avoir affaire à des individus à la fierté à fleur de peau, j'oscille précautionneusement entre procès-verbaux et matraques, sans néanmoins prendre trop de retard. Pourtant, elle s'éloigne de plus en plus de moi, alors même que son chevalier servant se rapproche dangereusement de sa belle et grosse auto, engin démoniaque qui ne fera qu'une bouchée de ses yeux en amande, couleur noisette. J'émerge enfin du slalom policier, et pense vaguement aux derniers cent mètres d'une course qu'avait regardée Juliette à la télé. Elle m'avait dit que le vainqueur était particulièrement bien foutu. Plus que cinquante mètres. C'est énorme, cinquante mètres, quand ils vous séparent de votre but, et que ce but s'apprête à aller faire l'amour à un con, probablement sur une banquette arrière en cuir clair. Pour la première fois, une jalousie longuement oubliée se réveille en pinçant mon ventre, et la testostérone vient se mélanger à l'adrénaline. Je me prépare à briser mon rythme de respiration pour lui crier de se retourner au moment où un dernier officier de police (ses épaulettes avaient l'air plus rutilantes que les autres) surgit d'un parking souterrain et se laisse percuter de plein fouet. Et merde. Je parcours sans grande conviction quelques derniers mètres avant qu'il ne me rattrape en poussant un juron.